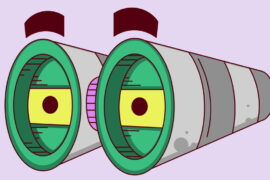Créativité vs productivité : le combat fait rage. Comment lutter contre la standardisation créative dictée par les algorithmes ? De quelle manière préserver l’inventivité humaine face à l’uniformité des nouvelles technologies ? À l’ère du digital, où les outils produisent du contenu à une vitesse vertigineuse, la singularité des idées semble s’estomper…
C’est fort de ses multiples expertises – rédacteur, graphiste, DA, DC et planneur stratégique – que Marc Hoffmann décrypte les nouveaux enjeux de la créativité et nous rappelle « ô combien l’humain est primordial ». 🤓 Cette interview inspirante est tirée de l’ouvrage de référence de Mohammed Ben Totoch : « Du brief au design« .
Ça pourrait changer un jour, mais pour l’instant, un designer humain, avec ses points de vue et son expertise unique, reste indispensable non ?
Pour ce qui est du design en communication, la productivité a bel et bien remplacé la créativité, comme dans tant d’autres secteurs sans doute. La course aux contenus s’est imposée par le digital. La belle époque de la publicité avec sa « big idea » est révolue. Quelle campagne contient encore aujourd’hui une bonne grosse grande idée pérenne ? Le message se dilue, se délite, dans les méandres du numérique à travers les réseaux sociaux, les applis, les sites. Qui pour plaire et complaire au plus grand nombre se ressemblent, s’assemblent en rassemblant les techniques, méthodes et process du moment qui « marchent » le mieux. L’originalité dérange et déroge aux règles de la productivité et de la rentabilité immédiate.
Donc, en fait non. L’unicité, la singularité, l’originalité ne sont plus essentielles. Le consensus est mou et surtout rassurant. On vous demande : faites comme un tel ou prouvez moi par 1 + 1 que votre « truc là » fonctionne et ensuite on se lance. C’est le lot quotidien du créatif. Moins d’audace, plus d’efficace, avec ou sans strass. Ce qui entraîne logiquement cette normalisation du normal, si banal. Faire ce qui se fait, plutôt que de faire autrement, différemment, ou originellement.
L’artificiel accentue cet état de fait, clichés, stéréotypes, biais et mensonges en prime. Parce que l’humain n’est pas que bon. Mais ô combien l’humain est primordial. Je veux encore croire que rencontrer, croiser, découvrir des gens uniques, échanger…. pas des clones, des calques, des avatars, des projections, des calibrés, des bornes ou des bots… sont les bonnes actions, les bonnes façons de stimuler sa propre créativité. (…)
Je veux encore croire que rencontrer, croiser, découvrir des gens uniques, échanger (…) sont les bonnes actions, les bonnes façons de stimuler sa propre créativité.
Pour un designer junior habitué au « no code » ou à glaner des fichiers sur des plateformes de partage, où est la limite entre assistanat et dépendance aux IA ?
Dépendance déjà ? Oui sans doute, tout porte à le croire. Il y a une sorte d’inéluctabilité et d’usage forcé de cette machine. Et céder à la facilité est si tentant.
Plutôt que de s’efforcer de composer l’image souhaitée en cherchant les éléments de sa composition, il est aisé de laisser faire un programme et de s’extasier devant un résultat aléatoire et encore bancal. Les images et les textes artificiels se reconnaissent encore vraiment. En plus de certains défauts, les mains à six doigts par exemple, elles ont une certaine lumière froide typique et un rendu plastique. (…) L’usage des ressources libres de droits disponibles sur le web est tout à fait différent. Il suppose quand même un minimum de recherche, d’interprétation, de déformation. L’idée n’étant pas de les utiliser telles quelles. Enfin quand on pousse sa créativité. Il y a toujours une touche personnelle à travailler.
En fait, au final, en créativité, il n’y a pas de tâches rébarbatives, même si elles sont répétitives. Au contraire, ces contraintes peuvent être stimulantes dans le sens où le temps pris à les exécuter permet de réfléchir au sujet, de faire évoluer l’idée. C’est aussi ça, être créatif. Et ça c’est sans doute une question de point de vue, voire de point de vie.
Les contraintes peuvent être stimulantes dans le sens où le temps pris à les exécuter permet de réfléchir au sujet, de faire évoluer l’idée.
En matière de créativité et d’inspiration il y a l’école avec méthodologie (…) et l’école qui y va au « talent » sans méthodologie. Avez-vous déjà pu l’observer en tant que directeur de création ?
Je suis évidemment de l’ancienne école. Avant tout ordi. Celle de la spontanéité avec pour seul méthode, celle de l’échange, de la curiosité, du plaisir, de l’enrichissement partagé, des notes sur papier, etc.
Un de mes premiers « mentors » en conception rédaction avait pour habitude de noter ses idées et accroches sur des post-it ! Il y en avait évidemment partout. C’est l’une des choses que j’ai apprises à cette période : la spontanéité. Coucher sur le papier toutes ses idées, elles serviront un jour. Ce n’est pas une méthode en soi, juste un réflexe, ou un rituel. Un autre m’avait aussi appris que la créativité était comme un muscle à entraîner autant que possible. Quand on voit quelque chose dans la rue, quand on entend les gens parler, tout est prétexte à se dire, se demander, si telle image ou telle expression peut devenir une idée communicante, un message intéressant. À force, ça devient presque naturel. Même obsessionnel.
Alors, savoir ce que l’on fait ou juste faire sans le savoir ? Il y a sans doute un peu des deux. (…) Créatif, rédacteur, photographe, directeur artistique, graphiste sont des métiers à plein temps qui ne s’improvisent pas ou se pratiquent par intermittence. C’est d’ailleurs un point critique de ce que promeut l’intelligence artificielle : que tout le monde puisse produire n’importe quoi ou en tout cas, écrire comme son écrivain préféré, produire des photos comme tel photographe, composer l’image de ses rêves et autres dérives bien sûr.
Voici venu le temps des petits princes augmentés avec leur désir de se faire dessiner un mouton arc-en-ciel à mille pattes volant dans le ciel de la planète Mars…
En fait, effectivement, la créativité ne s’apprend pas, pas vraiment, elle se stimule, se travaille, se cultive. Un créatif cherche en permanence, essaie, teste, note, gribouille, veille, fouille, maquette, prototype… Rien qui ne se fasse en un clic, comme un jeu de hasard où on lance une proposition en attendant que ça se fasse, que ça passe.
Alors, savoir ce que l’on fait ou juste faire sans le savoir ? Il y a sans doute un peu des deux.
Alors, c’est quoi le brief ?
Voilà la phrase qui démarre généralement une tonitruante réunion de création. Parfois, elle se termine aussi par cette même question. Et là, c’est le début de tout, de rien aussi. En fait, le brief n’est jamais clairement défini. En tout cas, personnellement, je n’en ai que très rarement entendu, vu ou lu, des briefs clairs, nets, précis, concis. Établir le brief en soi a toujours été la base d’un premier travail plus ou moins créatif.
En tout cas, théoriquement, le bon brief n’est certainement pas artificiel, mais intelligent. Dans le sens où le brief lui-même est le premier acte créatif. Et quand je dis créatif, j’entends singulier, pertinent, précis, simple, intelligible, inspirant. Il doit être bref, il est déjà une idée en soi.
Au bout de plus d’une trentaine d’années de réflexion créative, je retiens quatre points d’un brief. Qui parle à qui pour dire quoi et pourquoi. (…) Tout le reste – histoire de l’annonceur, contexte du marché, considéra- tions sociétales, pige de la concurrence – relève de la curiosité des créatifs impliqués. (…)
Toujours est-il que la créativité ne supporte pas la facilité comme solution. Et que cette matière première qu’est notre matière grise se travaille, se malaxe, se pétrit, se détend aussi, pour façonner un design, une idée, un concept. (…)
Le brief lui-même est le premier acte créatif.